Quelles sont les 6 étapes d'une succession ?
Comment ça fonctionne ? Lorsqu'une personne décède, plusieurs démarches notariales doivent être effectuées pour régler la succession. Ce processus complexe comporte plusieurs étapes pour déterminer:
- Les biens et les personnes concernés.
- Les droits de chacun sur ces biens.
- Leur attribution effective aux héritiers.
Dans les faits, les deux principales étapes sont :
La liquidation de la succession : Le notaire identifie, évalue et fixe la part des biens laissés par le défunt revenant à chaque héritier.
Le partage des biens : Les biens sont répartis entre les héritiers en attribuant des lots d'égale valeur. Entre ces deux étapes, les héritiers peuvent rester en indivision pendant plusieurs mois voire années.
Il existe deux causes d’ouverture d’une succession :
- La "mort certaine" (le décès).
- La "mort présumée" (l’absence et la disparition).
1. Le décès
La date et le lieu du décès : Selon le Code civil, les successions s’ouvrent au dernier domicile du défunt, et non au lieu du décès.Toutes les actions relatives à la succession (comme l’action en réduction)doivent être intentées devant les juridictions compétentes du dernier domicile.
Quelle est la différence entre certificat de décès et acte de décès ?
Le certificat de décès : un médecin appelé par la famille constate le décès et établit un certificat médical. Dans certaines communes, seuls les "médecins de l’État civil" peuvent constater le décès gratuitement pour les familles.
L’acte de décès : l'acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil sur déclaration d’une personne possédant des renseignements exacts sur le défunt.Cette déclaration doit être faite dans les 24 heures suivant le décès, sous peine de contraventions. L’acte de décès doit mentionner des informations précises telles que le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, noms et professions des parents, et les informations sur le déclarant.
En cas de disparition ?
Si une personne est présumée décédée sans que son corps ne soit retrouvé (catastrophe aérienne, naufrage, etc.), toute personne intéressée peut demander une déclaration de décès en justice. Cette déclaration est faite auTribunal de grande instance du lieu de la disparition, ouvrant ainsi la succession du disparu et dissolvant son mariage.
En cas d’absence ?
L'absence est une situation où une personne a disparu sans donner de nouvelles, sans qu’on sache si elle est vivante ou décédée. La procédure judiciaire d'absence comporte deux phases :
Absence présumée vivante :
un jugement de présomption d’absence peut être rendu après dix ans sans nouvelles.
Absence présumée décédée :
après une période de 20 ans ou de 10 ans avec un jugement de présomption d'absence, un jugement de déclaration d'absence est rendu, permettant l’ouverture de la succession.
2. Qui sont les d’ayants-droits ?
Les héritiers et légataires
Le défunt peut instituer des légataires dont les parts dépendent de la présence d’héritiers réservataires. La loi fixe également les héritiers selon l'ordre successoral.
Remarque : en cas d’absence présumée, la personne est présumée vivante et peut hériter.Si l'absence est déclarée, elle ne peut plus hériter, mais les successions recueillies pendant la période d'absence restent incluses dans sa propre succession.
La preuve de la qualité d’ayant-droit : la qualité d’héritier/légataire peut être prouvée par un acte de notoriété, un certificat d’hérédité ou une pétition d'hérédité.
L’acte de notoriété : cet acte, établi par un notaire, atteste de la qualité d’héritier/légataire. Il mentionne les pièces justificatives comme les actes de naissance et de mariage.L’acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le certificat d’hérédité : demandé à la mairie pour des successions simples, il n'est délivré qu’en l’absence de complications (biens immobiliers, testaments, etc.).
La pétition d’hérédité : action en justice pour faire valoir ses droits d’héritier/légataire.
Les droits des héritiers
Les héritiers désignés par la loi héritent des biens, droits et actions du défunt dès l’ouverture de la succession. Ils ne sont responsables des dettes qu'à hauteur de leur part successorale.
2.3. L’Option des Héritiers : les héritiers peuvent accepter purement et simplement la succession, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer à la succession. La décision doit être prise dans un délai de 10 ans.
3. La liquidation civile de la succession
La liquidation civile de la succession implique plusieurs étapes cruciales pour la répartition des biens du défunt :
L’ouverture de la succession
La succession s'ouvre par le décès du défunt et s'accompagne de l’inventaire des biens, droits et obligations du défunt, réalisés par le notaire.
Le règlement des dettes et charges
Avant toute répartition, les dettes et charges de la succession doivent être réglées. Cela inclut :
- Les frais funéraires.
- Les dettes fiscales (impôts, taxes).
- Les dettes personnelles du défunt.
De quoi est composé la succession ?
L’actif successoral est constitué de tous les biens meubles et immeubles du défunt, ainsi que de ses droits et créances. Le notaire réalise cet actif pour déterminer la masse successorale nette après déduction des dettes.
Comment le partager ?
Une fois l'actif net déterminé, le partage peut intervenir, qu’ilsoit amiable ou judiciaire.
Le Partage Amiable : Les héritiers peuvent s'entendre sur la répartition des biens. Cet accord est formalisé par un acte notarié.
Ou
Le partage judiciaire : En cas de désaccord, le partage est ordonné par le tribunal. Un expert peut être désigné pour évaluer les biens et proposer un projet de partage.
Quelle fiscalité ? (Voir article du barème précis + lien)
Les droits de succession doivent être acquittés par les héritiers selon leur degré de parenté avec le défunt et la valeur de leur part héréditaire. Les barèmes et abattements fiscaux varient selon ces critères.
Les Abattements : chaque héritier bénéficie d'un abattement personnel sur la part qui lui revient, dont le montant dépend de son lien de parenté avec le défunt.
Les Taux de Droits de Succession : les taux appliqués après abattement varient selon le degré de parenté :
- Enfants : barème progressif de 5% à 45%.
- Frères et sœurs : 35% ou 45%.
- Autres héritiers : taux forfaitaires plus élevés.
4. Les frais de succession
Frais notariaux
Les frais notariaux incluent les honoraires du notaire, qui varient en fonction de la valeur de la succession. Ces frais comprennent les droits de mutation, les émoluments (rémunérations) de formalités et de négociation, ainsi que les débours (frais avancés par le notaire).
Frais de règlement de dettes
Les frais engagés pour régler les dettes du défunt, comme les impôts ou les factures en cours, sont également à prendre en compte. Ces frais sont généralement déduits de l'actif successoral avant le partage.
5. Les déclarations fiscales
La déclaration de succession
Les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale dans les six mois suivant le décès (ou un an si le décès a eu lieu à l'étranger). Cette déclaration détaille les actifs et les dettes du défunt, ainsi que les parts revenant à chaque héritier.
L’imposition des plus-values
Si les biens successoraux sont vendus, les plus-values réalisées peuvent être imposées. Les héritiers doivent alors déclarer et payer l'impôt sur les plus-values.
6. La transmission des biens
Comment sont transmis les biens ?
Une fois la succession liquidée, les héritiers deviennent propriétaires des biens qui leur sont attribués. Ce transfert de propriété peut nécessiter des formalités spécifiques, notamment pour les biens immobiliers (publication au bureau des hypothèques).
Comment gérer le patrimoine transmis ? Peut-on l’optimiser ?
Les héritiers doivent ensuite gérer les biens reçus, ce qui peut inclure la mise en location, la vente, ou l'entretien des biens immobiliers.Des conseils en gestion de patrimoine peuvent être utiles pour optimiser cette gestion.
Les cas particuliers
Si les biens ne sont pas uniquement en France ?
Les successions internationales, où le défunt possédait des biens dans plusieurs pays ou avait des héritiers résidant à l'étranger, peuvent compliquer le processus. Des règles spécifiques de droit international privé s'appliquent alors.
Le cas de successions complexes
Certaines successions, en raison de la composition des actifs (entreprises, œuvres d'art) ou de la situation familiale (conflits entre héritiers, enfants de différentes unions), peuvent être particulièrement complexes à gérer et nécessiter une expertise spécialisée, n'hésitez pas à vous faire accompagné par des professionnels et n'ayez pas peur de demander un contre-avis.
Lexique
Indivision : Situation dans laquelle plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien sans division matérielle de celui-ci.
Action en réduction : Procédure visant à réduire les donations et legs du défunt pour protéger la part réservataire des héritiers.
SIE : Service des Impôts des Entreprises.
Certificat d’hérédité : Document attestant la qualité d’héritier, délivré par la mairie.
Pétition d'hérédité : Action judiciaire pour faire reconnaître sa qualité d’héritier ou de légataire.
Usufruit : Droit de jouir des biens dont un autre à la propriété.
Nue-propriété : Droit de propriété dont les attributs de jouissance sont détenus par un autre (l’usufruitier).
Actif net : Valeur des biens après déduction des dettes et charges.
Partage amiable : Répartition des biens d'une succession par accord entre les héritiers.
Partage judiciaire : Répartition des biens d'une succession par décision de justice en cas de désaccord entre les héritiers.

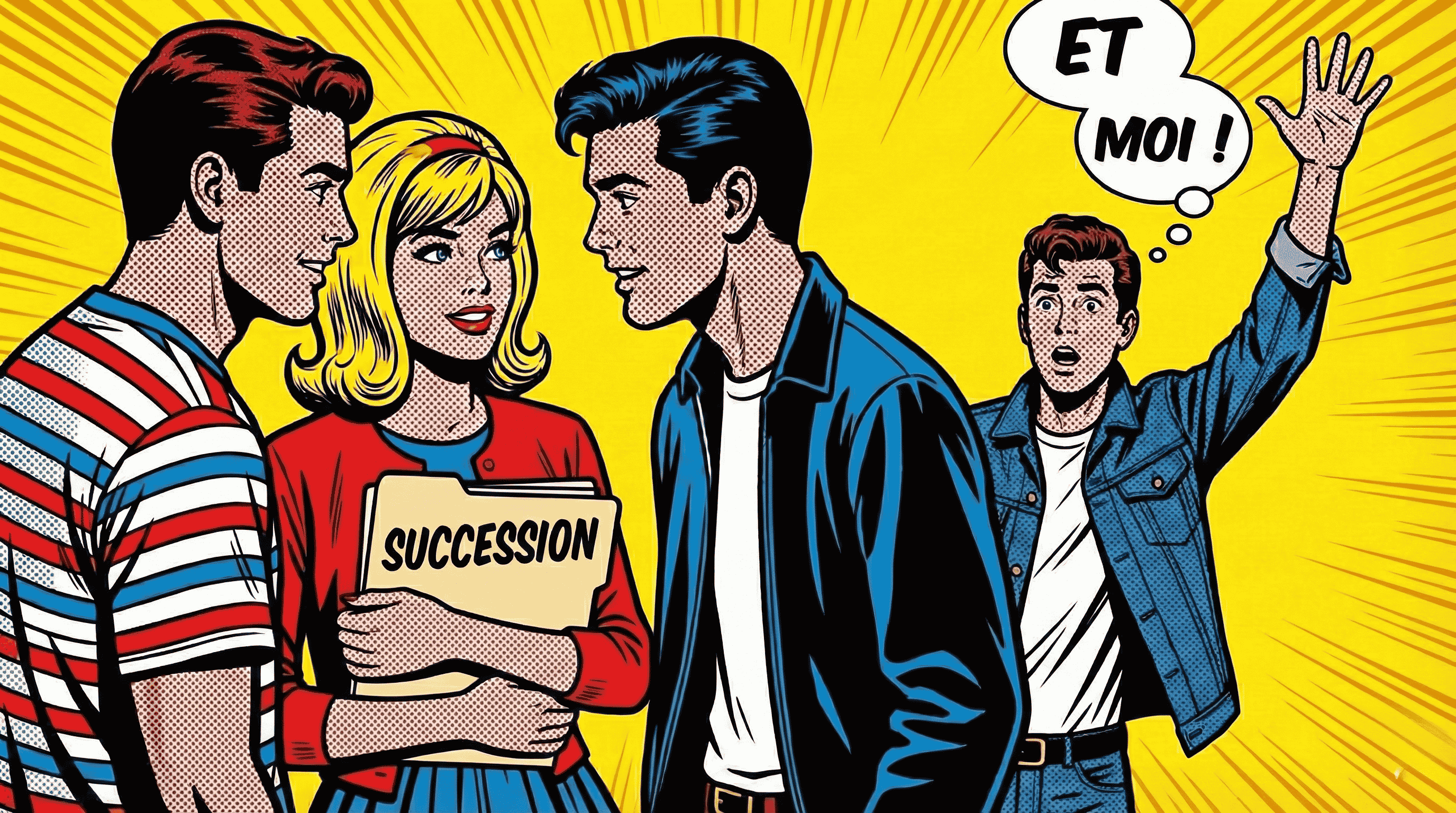

.png)